« Comment offrir à son enfant la meilleure vie possible ? ».
C’est à cette interrogation qu’Isabelle Mordant entend répondre dans son ouvrage « Mystère de la fragilité » (Éditions du Cerf).
À 25 ans, Isabelle Mordant devient mère de Thomas, son premier enfant. Ce qui devait constituer un bonheur immense, avec son mari Paul, se transforme en épreuve. En effet, peu après la naissance de leur fils, ils observent, impuissants, la souffrance et les cris de ce dernier du fait de nombreuses fractures dont la cause est inexpliquée. Sollicité, le corps médical est incapable, dans un premier temps, de mettre des mots sur le mal qui ronge Thomas sinon pour porter à l’encontre des parents une accusation infondée, celle de la maltraitance.
La réalité, connue plus de douze ans après les faits, est tout autre et s’explique par une forme récessive de fragilité osseuse qui a pour conséquence, en l’espèce, une forte dépendance physique de Thomas obligeant à un accompagnement de chaque instant créant de fait une situation de lourd handicap.
Loin d’être misérabiliste, cet ouvrage narre l’histoire pleine d’espoir d’une mère fière de son enfant. Il y est finement dépeint la lutte incessante d’un particulier contre une administration dont les décisions semblent parfois irréelles, et d’un corps médical et professoral ne sachant toujours apporter des solutions prenant en compte la différence, en général, et le handicap, en particulier. De fait, outre ses proches, ce sont des individus, à l’instar de certains médecins et enseignants qui contribueront à ce que Thomas, doué de capacités intellectuelles exceptionnelles, fasse non seulement des études qui plus est longues, mais aussi intègre une classe préparatoire, le lycée Hoche, avant d’entrer à l’École normale supérieure, et ce, dès l’âge de seize ans.
Si le livre offre le portrait d’un garçon joyeux et équilibré, c’est aussi grâce à ses parents que Thomas dispose de la meilleure vie possible. Cette vie, Isabelle Mordant la définit ainsi :
« Il me reste une liberté : la façon dont j’affronte la réalité. Je ne peux éviter les fractures de Thomas, mais je peux choisir de tout faire, par mon attitude et par mes gestes, pour l’aider à surmonter la douleur. Je ne peux le guérir de son handicap, mais je peux agir pour qu’il puisse mener la belle vie qu’il désire et pour lui donner toutes ses chances d’être heureux. Cette liberté peut sembler dérisoire, mais à moi, elle paraît immense. Et la responsabilité qui l’accompagne n’est pas moindre. En faire usage est un exercice d’équilibre périlleux. Tous les jours, c’est un combat. Il y a quelques grandes victoires, exaltantes, dignement fêtées, et aussi une multitude de petites chutes. Chaque jour, la vie de Thomas, sa dépendance, ses souffrances, et sa joie, son appétit de vivre, sa très grande force morale, ébranlent mes certitudes, ma conception du monde et de la vie. Il n’y a pas de place pour le confort, pour l’habitude, pour le repos. Cette aventure que nous vivons avec Thomas est bien loin de se limiter aux contraintes, aux soucis et aux malheurs. Bien plus profondément, c’est une aventure spirituelle et philosophique. »


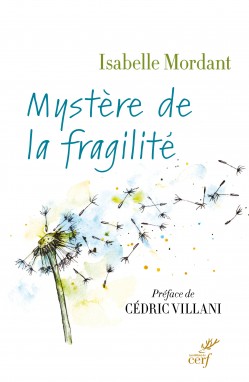
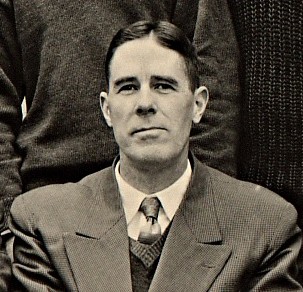
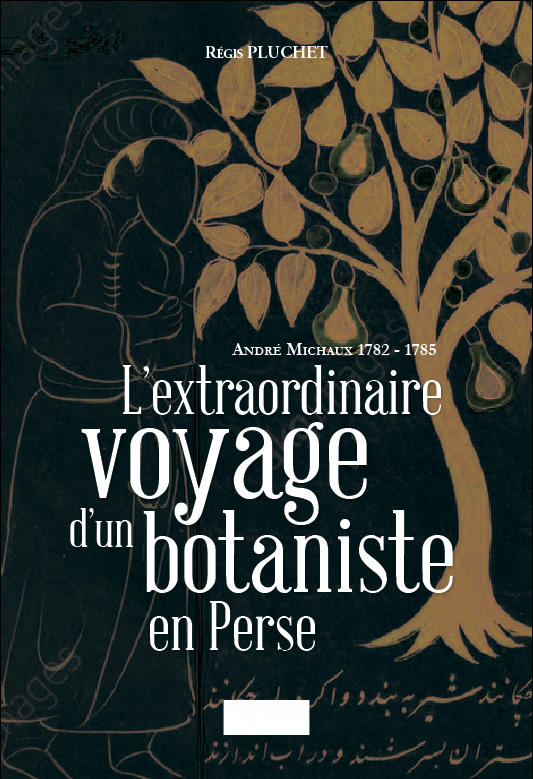
![COUV MICHAUX[2]](http://www.ancienshoche.org/wp-content/uploads/2014/08/COUV-MICHAUX2-300x206.png)